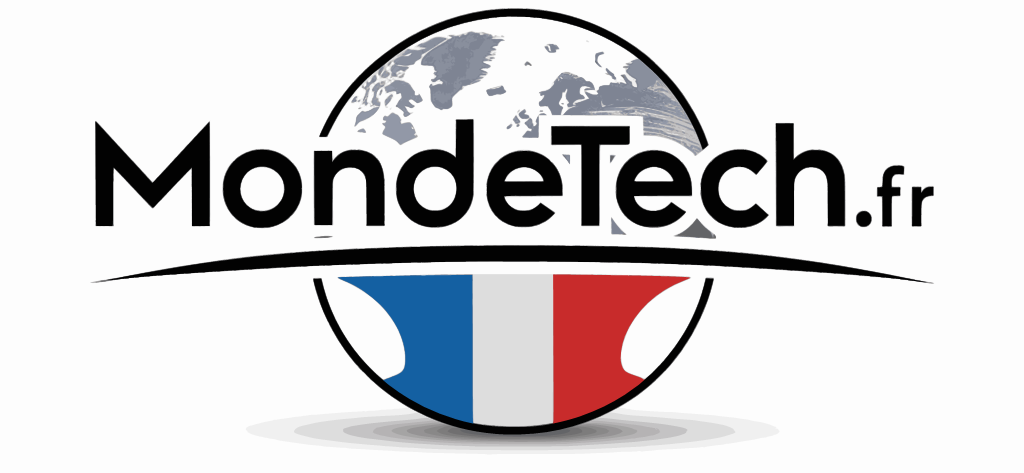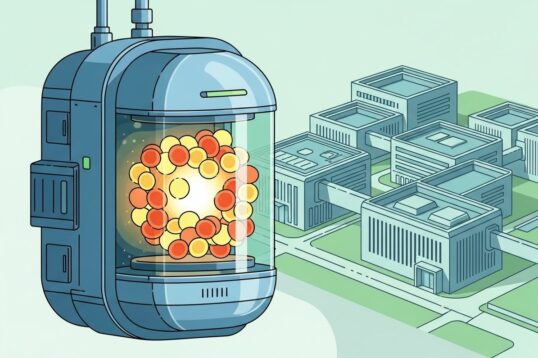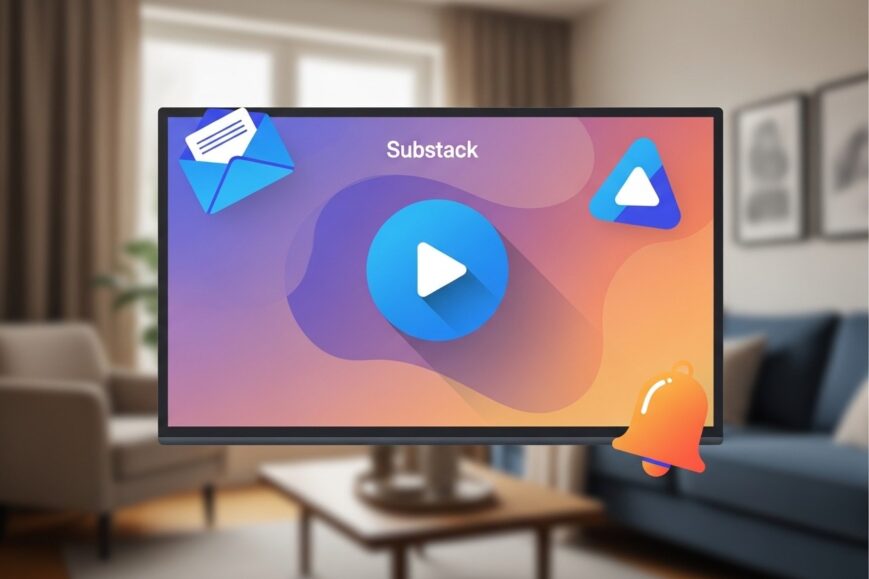Imaginez : vous roulez 16 heures par jour sous 45 °C à New Delhi pour livrer des burgers ou des courses en moins de 10 minutes. Vous gagnez parfois 30 000 roupies par mois, parfois 8 000. Vous n’avez ni congé maladie, ni retraite, ni assurance si vous vous cassez une jambe. Et puis, un vendredi de novembre 2025, le gouvernement indien annonce que vous avez enfin un statut légal. Victoire ? Pas vraiment. C’est exactement ce qui vient de se passer pour plus de 12 millions de gig workers en Inde.
Une réforme attendue depuis cinq ans
Le 21 novembre 2025, le Code on Social Security, l’un des quatre nouveaux codes du travail votés en 2020, est enfin entré en vigueur. Pour la première fois dans l’histoire indienne, les termes « gig worker » et « platform worker » figurent noir sur blanc dans la loi. Les livreurs Swiggy, les chauffeurs Ola ou Rapido, les préparateurs de commandes Blinkit ou Zepto ne sont plus des fantômes juridiques.
Concrètement, les plateformes devront verser entre 1 et 2 % de leur chiffre d’affaires annuel (plafonné à 5 % des paiements faits aux travailleurs) dans un fonds national de sécurité sociale géré par l’État. En échange, les travailleurs devraient – un jour – bénéficier de l’assurance maladie ESIC, d’un fonds de retraite et d’une assurance accidents.
« C’est une étape historique… mais les bénéfices concrets risquent de prendre des années à arriver. »
– Balaji Parthasarathy, professeur à l’IIIT Bangalore et responsable du projet Fairwork India
Pourquoi cette réforme arrive maintenant
L’Inde compte aujourd’hui la gig economy la plus dynamique du monde après la Chine. Les chiffres donnent le vertige :
- Plus de 12 millions de travailleurs actifs (estimation NITI Aayog)
- Croissance prévue à 80 millions de gig workers d’ici 2030
- 90 % des nouveaux emplois créés dans le secteur informel depuis 2019
Face à cette explosion, le gouvernement Modi ne pouvait plus ignorer la question. Surtout quand les grèves de livreurs paralysent régulièrement Mumbai ou Hyderabad et que les syndicats menacent de manifestations nationales.
Le diable se cache dans les détails (et ils sont nombreux)
Sur le papier, tout semble beau. Dans la réalité, presque rien n’est prêt :
- Aucun schéma précis de prestations n’a encore été notifié
- Les conseils de sécurité sociale (central et par État) ne sont pas constitués
- Le portail E-Shram n’a enregistré que 300 000 travailleurs sur 10+ millions
- Aucune plateforme ne sait encore comment calculer ou verser la contribution
Résultat : même si la loi existe, aucun livreur ne touchera un seul roupie de protection sociale avant des mois, voire des années.
L’inégalité entre États : le grand bug du fédéralisme indien
En Inde, le travail figure sur la « concurrent list » : le centre fixe le cadre, mais les États mettent en œuvre. Et là, c’est la loterie.
Le Rajasthan avait voté une loi pionnière en 2023… qui dort toujours dans les tiroirs. Le Karnataka, lui, a déjà mis en place son Gig Workers Welfare Board. Résultat : un livreur à Bangalore aura (peut-être) des droits que son collègue à Jaipur n’aura jamais.
« Les protections dépendront plus de l’État où vous travaillez que de la loi nationale elle-même. »
– Aprajita Rana, avocate chez AZB & Partners
Ce que les plateformes en disent (et ce qu’elles pensent vraiment)
Officiellement, tout le monde applaudit. Amazon « soutient l’intention du gouvernement ». Zepto parle d’« un grand pas vers des règles plus claires ». Zomato (rebaptisé Eternal) assure dans un communiqué boursier que l’impact financier sera « gérable ».
En coulisses, c’est une autre histoire. Les équipes compliance passent leurs nuits à essayer de comprendre comment :
- Identifier les travailleurs qui bossent pour plusieurs apps
- Éviter les doubles contributions
- Mettre en place des mécanismes internes de règlement des griefs
Car oui, la loi impose aussi aux plateformes de créer des comités de griefs. Une petite révolution pour des boîtes habituées à désactiver un compte en un clic sans explication.
Le vrai problème : les gig workers ne veulent pas (seulement) de la sécu
Parlez à n’importe quel livreur, il vous dira la même chose : la retraite à 60 ans, très peu pour lui. Ce qu’il veut, c’est :
- Un revenu minimum garanti par course
- Ne plus se faire désactiver sans motif
- Une transparence sur les algorithmes qui décident des incentives
- Des toilettes et des zones de repos dans les hubs
Or la nouvelle loi ne répond à aucune de ces demandes. Pire : en créant une catégorie juridique séparée, elle enterre définitivement la possibilité de reconnaître les gig workers comme salariés – contrairement au Royaume-Uni, à l’Espagne ou même à certains États américains.
« Le gouvernement a tranché : ces travailleurs ne seront jamais des employés. »
– Ambika Tandon, chercheuse à Cambridge et affiliée CITU
Et maintenant ? Trois scénarios possibles
Scénario 1 – Le meilleur : Quelques États progressistes (Karnataka, Telangana, Kerala) mettent rapidement en place des conseils fonctionnels et des prestations généreuses. Les autres suivent sous la pression syndicale.
Scénario 2 – Le plus probable : Un patchwork inégalitaire s’installe. Les plateformes traînent les pieds sur les contributions. Les travailleurs continuent de manifester.
Scénario 3 – Le pire : Les États et le centre se renvoient la balle pendant des années. Le fonds reste vide. La loi devient une coquille vide, comme tant d’autres en Inde.
Ce que ça change pour les startups et investisseurs
Si vous levez des fonds pour une startup indienne dans le quick commerce, la logistique ou la mobilité, intégrez dès maintenant ces nouvelles contraintes :
- 1 à 2 % de CA en plus en coût structurel
- Obligation de compliance État par État
- Risque réputationnel en cas de grèves médiatisées
À l’inverse, les startups qui sauront traiter décemment leurs travailleurs (paiement rapide, transparence algo, repos) auront un avantage compétitif énorme dans les années à venir.
Conclusion : une demi-victoire qui en dit long
L’Inde a franchi un cap symbolique énorme en reconnaissant l’existence légale de ses gig workers. Mais en refusant de leur accorder le statut de salariés et en laissant l’implémentation aux États, elle a aussi choisi la solution la moins coûteuse politiquement et économiquement.
Pour les millions de livreurs qui se lèvent à 6 h du matin pour enchaîner les commandes jusqu’à minuit, rien ne changera avant longtemps. Et c’est peut-être la leçon la plus cruelle : dans l’économie des plateformes, la reconnaissance juridique ne remplit pas l’estomac.
À suivre de très près. Car ce qui se joue en Inde aujourd’hui préfigure probablement ce qui arrivera demain en Indonésie, au Nigeria, au Brésil… partout où la gig economy explose sans filet de sécurité.